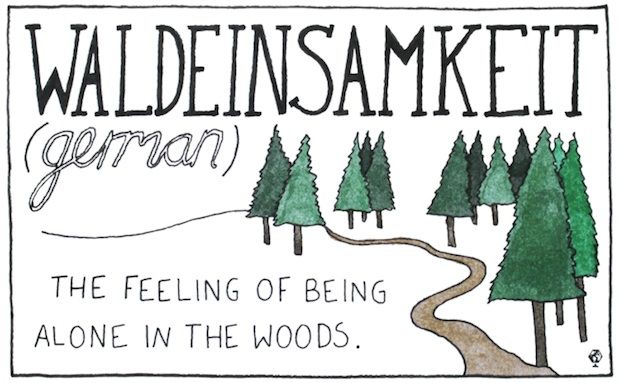Mudwoman de Joyce Carol Oates
Nous ne sommes pas fait que de chair et d'os. La "pâte" dont nous sommes fait peut varier selon les types, selon les événements, selon les histoires. M. R. Neukirchen est de ceux (de celles) qui sont pétris de boue et dont les racines sont invisibles. Comme ces arbres des marais, des mangroves, dont le tronc débouche tout à coup sous nos yeux sans savoir ce qui repose et ce qui retient toute cette masse, en dessous. Il n'y a pas toujours que de l'humain en nous. M. R. Neukirchen en est la preuve : il y a de l'inhumain, de l'inconscient, de l'impensé, de l'oublié, de la matière brute, de l'animal. Si le personnage ici semble pure abstraction au départ, il devient si concret, si dur, si primitif, à mesure que l'histoire se déroule, que c’en est déroutant. Le tour de force tient à cela : M. R. devient presque trop réelle, trop brutale, trop proche. On sentirait presque l'odeur de boue sur l'oreiller.
"C'était cela la condition humaine, peut-être ? - l'effort de demeurer humain."
Il est évidemment question dans ce roman de la recherche de soi, de la quête d'identité, de la volonté (tantôt consciente, tantôt inconsciente) de se trouver, de savoir par-dessous tout et contre tout. Savoir ce qu'il y a avant, avant cette réussite, avant ce statut de présidente d'université, avant cette brillante carrière et ces illustres études, avant ces deux parents adoptifs aimants. Mais ce savoir ne s'accommode guère d'une réflexion logique et claire. Ce n'est pas de la philosophie, M. R. l'apprend à ses dépens. Loin de se douter de ce qui se conspire en elle et dans sa vie, M. R. se laisse d'abord doucement vaquer aux événements. Et nous aussi. Avec un plaisir malsain et pervers, nous (lecteurs) nous laissons conter l'histoire de cette femme. A aucun moment ne m'est venue l'envie d'arrêter. C'est une lecture qui devient pulsionnelle et habitée. C'est une lecture vorace et addictive, dans laquelle nous sommes pieds et poings embourbés.
De toutes les aventures et les embarras de Mudwoman, ce qui reste après fermeture des pages est l'image de la terre humide (la boue) et des racines souterraines (ou subaquatiques : sous l'eau du marais) entrelacées. Mudwoman est un mélange osé de ces deux matières et elles ne cessent de résonner en elle et dans le récit. La quête définitive de Mudwoman reste celle de l'endroit E, celui où elle aurait dû mourir, mais où elle n'est pas morte ; donc celui de la boue et de la vase, tout au fond d'un coin de nature abandonné du monde.
Et pourtant, que c'est loin tout cela de la philosophie. Du statut renommé de présidente d'université, de professeur éminent de philosophie. J'aurais d'ailleurs apprécié que le paradoxe entre les deux (le savoir universitaire, en l'occurrence philosophique, et la matière brute, la folie aussi) soit poussé encore plus loin.
"Première femme, première année. Premier président femme de l'Université.Quelle reconnaissance elle éprouvait ! Mais aussi quel ressentiment ! Première femme. Pourquoi était-ce aussi important. Pourquoi le sexe était-il aussi important ! C'était un paradoxe classique de la philosophie : où est le moi ? Dans le corps ou dans... l'âme ? Existe-t-il une âme, d'ailleurs ? Existe-t-il un moi ? Ou plutôt... des moi ? Ou plutôt (l'horreur la plus probable, dans la lumière crue du jour au sortir d'une nuit d'insomnie) pas de moi autre qu'une matière cérébrale perpétuellement menacée d'anéantissement."
Mudwoman évite l'anéantissement avec une force pure, bestiale, une force insoupçonnée mais pourtant bien là. Comme elle s'est échappé de la boue, elle s'est extirpée de la fange (littérale et figurée), comme Baudelaire, M. R. a changé la boue en or, et comme un soldat en plein champ de bataille, elle néantisera tout obstacle qui sera sur son passage. C'est un récit de force et de vaillance, de courage et de cœur qui ne laisse pas insensible. En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à lire un roman aussi puissant, aussi dur psychologiquement, sous ses airs simples, abordable et innocent. Résolue à vivre ce que sa vie est réellement, à ce que son histoire est (a été), c'est un exemple de courage (parfois plus ou moins conscient d'être tel) dans des situations qui sont, en principe, impossibles à voir en face, à penser. En définitive, M. R. doit accepter avec nous le temps qui fait les êtres et les choses, ce temps qui est insurmontable et indépassable.
"Mais alors tout ceci n'aurait pas pu arriver, pensa-t-elle. Or c'est arrivé.
Le temps terrestre est irréversible. Le temps terrestre ne s'écoule que dans une seule direction."